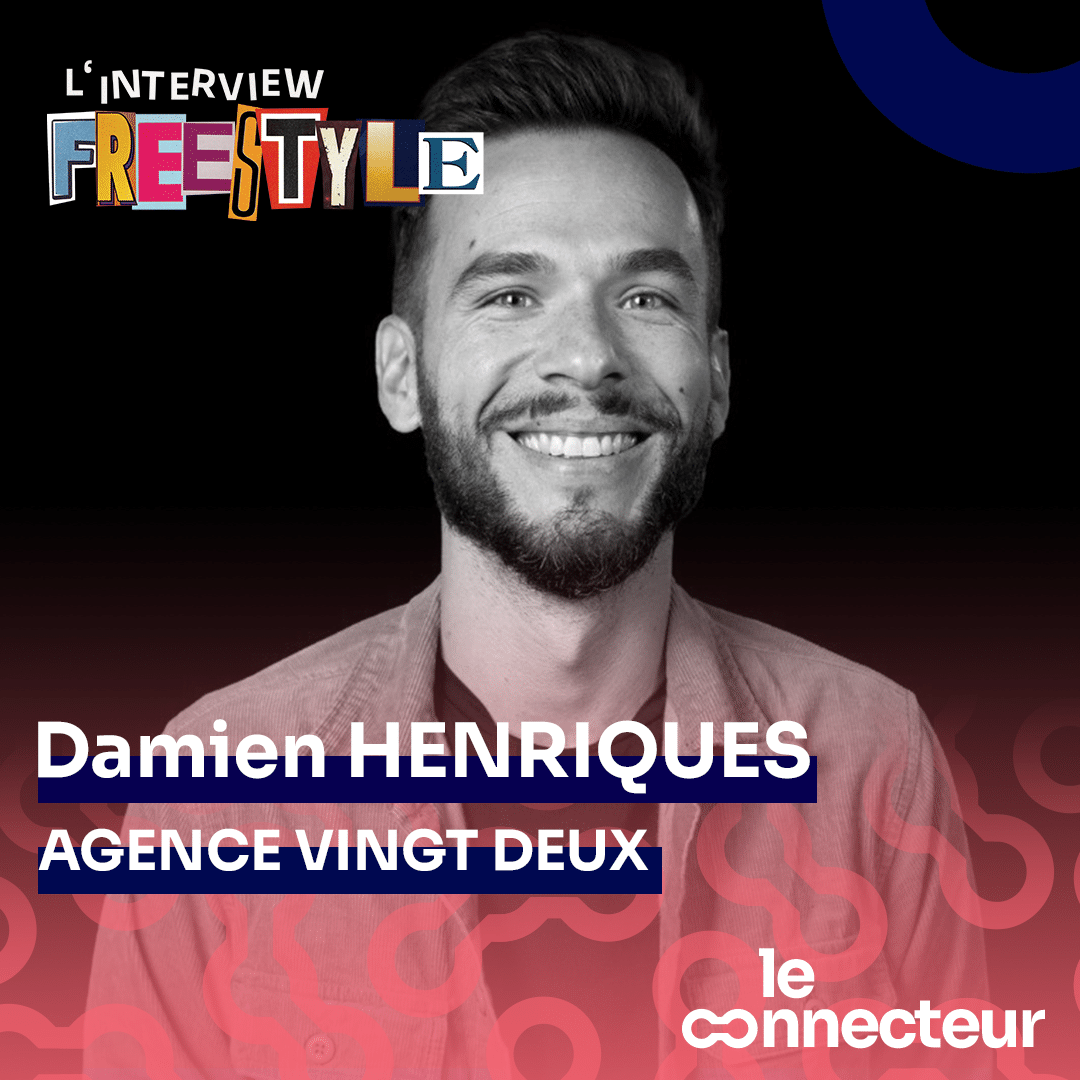Le rectorat de Clermont-Ferrand a tenu une conférence le 21 janvier 2025. De nombreux intervenants provenant d’univers différents ont décortiqué tous les enjeux autour du métier de journaliste, allant des dangers auxquels ceux-ci sont confrontés, aux excès de certains membres de la profession.
Le journalisme au coeur de différentes crises.
Thibaut Bruttin, directeur général de Reporters sans frontières, fait un état des lieux du journalisme. Il met en avant les différentes menaces auxquelles le secteur doit faire face. Pour rappel, Reporters sans frontières est une association possédant un réseau important partout dans le monde. Elle accompagne les journalistes, enquête et alerte le monde sur les pressions et attaques que peut subir le secteur. Selon Thibaut Bruttin, les médias font face à quatre crises : une crise géopolitique, économique, technologique et de confiance.
Dans une dimension géopolitique, on s’aperçoit que les journalistes deviennent des cibles privilégiées. Des individus peuvent les prendre en otage, les exécuter quand ils deviennent des témoins gênants. Paradoxalement, alors qu’ils ne font que leur travail, ils sont considérés comme une menace par certains.
Économiquement, on s’aperçoit que dans le monde, des personnes fortunées, plus ou moins proches du pouvoir, détiennent une très grande majorité des médias. Cette proximité est un risque car l’indépendance des médias n’est plus garantie. Les journalistes sont parfois contraints de limiter leurs sujets pour ne pas agir contre les intérêts économiques des différents groupes qui les détiennent. Mais aussi, dans une moindre mesure, de ne pas aller à l’encontre de la vision politique des détenteurs de ces médias. Dans certains pays, sans citer lesquels, Reporters sans frontières constate que cette concentration est strictement encadrée, empêchant les journalistes de subir des pressions en interne. La concentration n’est donc pas forcément un obstacle à l’indépendance. La France n’est, en majorité, pas dans ce cas de figure.
Focus sur le journalisme en France.
Dans l’Hexagone, de grandes fortunes détiennent la majorité des médias. En France, selon une étude coordonnée par Julia Cagé et Olivier Godechot, 80% des médias sont détenus par des entreprises privées dont la grande majorité sont des hommes d’affaires importants (Bernard Arnault, Xavier Niel, Vincent Bolloré etc…) une autre partie par des propriétaires privés et un très faible pourcentage sous forme associative. Ceux-ci garantissent leur indépendance en contrôlant strictement leur capital (par exemple Mediapart ou le Canard enchaîné). Surveillant dès lors qui peut acheter ou non des parts du média.
Dans une moindre mesure, la technologie est également une menace pour l’information. L’arrivée de l’intelligence artificielle rend le travail de vérification des sources difficile. De nombreuses fausses informations circulent, et les réseaux sociaux représentent une menace supplémentaire envers une information libre et indépendante. Et c’est là où le bât blesse : toutes ces conditions entraînent une crise de confiance des citoyens envers les journalistes et médias. Thibaut Bruttin évoque un sondage où 62% des Français ressentent une défiance envers les médias.
Des solutions réalistes.
Le tableau dépeint semble négatif. Néanmoins, pour le Directeur Général de Reporters sans frontière des solutions existent. Les médias doivent accroître leur transparence. C’est-à-dire instaurer une charte pour garantir l’éthique et indépendance de la profession. Les États, quant à eux, doivent, d’une part, mettre en place une éducation aux médias et à l’information pour restaurer la confiance avec les citoyens. Et d’autre part, garantir la sécurité des journalistes pour qu’ils puissent exercer sereinement leur métier. Dans un autre registre, il ne faut pas oublier les risques liés à l’ingérence étrangère. Phénomène qui existe depuis toujours mais qui tend à se renforcer ces dernières années.
Une démocratie en proie aux fausses informations.
Claire Benoit est directrice adjointe de Viginum, service rattaché au secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale. Celui-ci traite des ingérences étrangères en ligne. Créé après l’assassinat de Samuel Paty, le service a pour but de protéger l’information contre toute intervention étrangère. La France, par son principe de laïcité et par son droit au blasphème, fait l’objet de beaucoup d’attaques, notamment en ligne.
Dans le principe, Viginum ne s’occupe que des personnes agissant pour le compte de pays étrangers qui tenteraient de manipuler le débat public, menaçant ainsi la sécurité nationale. Il protège par exemple les événements politiques comme les élections pour éviter que les citoyens soient influencés. L’objectif ici n’est pas de traquer les fausses informations mais d’éviter que les vraies informations soient manipulées à des fins politiques. De même, elle précise que ce n’est pas un service de renseignement, car les membres de Viginum n’ont accès qu’aux informations grand public et en open source.
Une volonté de transparence.
Le service technique publie aussi différents rapports destinés au grand public. On retrouve par exemple une synthèse de la menace informationnelle lors des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024. Viginum collabore également avec de nombreux acteurs comme les ministères, les journalistes et le monde éducatif. Il éduque aux bonnes pratiques pour avoir une information vérifiée. L’existence de ce service démontre à quel point l’information peut être une arme puissante, qui peut avoir des conséquences importantes sur nos sociétés.
Des médias qui tentent constamment de se réinventer.
Kati Bremme, directrice de la rédaction à France Télévisions, Philippe Morand, rédacteur en chef adjoint pour TF1, et Stéphane Vergeade, directeur éditorial du journal La Montagne sont tous d’accord sur un point. Les journalistes doivent instaurer un rapprochement avec leurs auditeurs. Un rapport commandé par l’institut Reuters en 2024 démontre que, pour s’informer quotidiennement, la majorité des jeunes se tournent vers le youtubeur HugoDécrypte. S’informant dès lors moins par les médias traditionnels.
Le directeur éditorial du journal La Montagne, rappelle néanmoins que les réseaux sociaux poussent les professionnels des médias à aller toujours plus vite pour être visibles. Il met en garde sur le fait que le travail du journaliste doit avant tout être de bien informer plutôt que de diffuser en premier. Concernant les fausses informations, les intervenants insistent sur la vérification des faits dans un monde médiatique de plus en plus rapide. Par exemple, TF1 a mis en place une section spéciale de fact-checking pour mettre en avant les fausses informations et les décrédibiliser.
Une intelligence artificielle au coeur des enjeux.
De la même manière l’encadrement sur l’utilisation de l’intelligence artificielle dans les rédactions, petites ou grandes est essentiel. En effet, celle-ci ne peut être évitée mais doit être contrôlée. Pour éviter les abus, les trois intervenants évoquent donc une charte déontologique qu’ils ont mise en place. Celle-ci évolue chaque jour.
Cette conférence nous permet à tous de mieux appréhender les différentes menaces auxquelles font face les médias. Très diverses, celles-ci peuvent freiner, voire empêcher le travail journalistique. Néanmoins, des solutions existent afin que la déontologie du milieu soit respectée. L’évolution technologique via l’intelligence artificielle amène également son lot de difficultés et oblige les journalistes à se réinventer pour proposer une information toujours plus fiable.