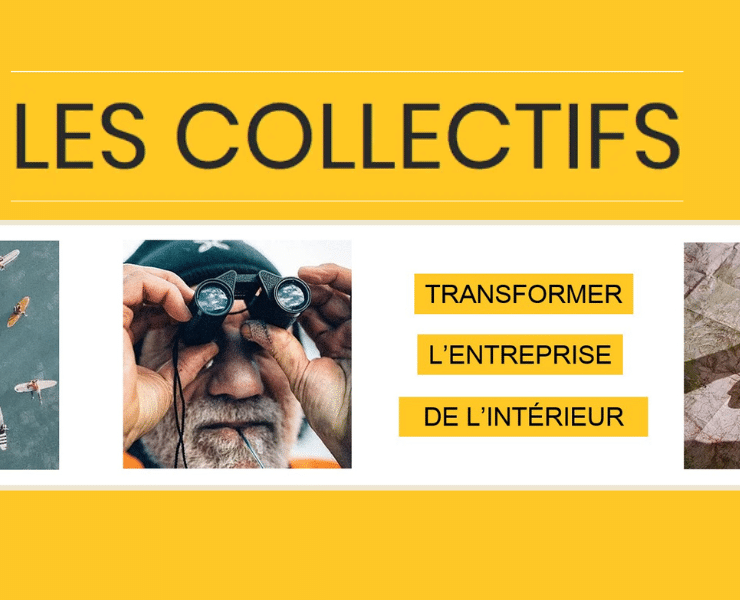« Ras-le-bol des médias : comment y remédier ? » — le titre du débat donne le ton. C’était l’un des temps forts du Festival de l’Info Locale, organisé à Nantes par Ouest Média Lab. Un débat ouvert au grand public dans une programmation de deux jours dédiée aux professionnels des médias.
La fatigue informationnelle n’est plus une impression passagère, mais une tendance lourde, en France comme ailleurs. Ce que les chercheurs décrivaient déjà en 2017 est aujourd’hui confirmé par les chiffres : une partie croissante du public décroche de l’actualité, voire s’en détourne complètement. D’ailleurs, à la question ‘pourquoi vous êtes là’ posée par le modérateur des débats, une personne du public a répondu « parce que je suis complètement concernée: je ne m’informe plus, tout est négatif, et je me demande bien ce qu’on peut y faire ».
Quand s’informer fait plus de mal que de bien
Les données présentées par Gilles van Kote (Le Monde) et David Medioni (Fondation Jean-Jaurès) illustrent le propos. Selon l’étude du Reuters Institute, 40 % des personnes interrogées dans 50 pays évitent désormais l’information, contre 29 % en 2017. Par ailleurs, toujours en France, 46 % des personnes interrogées se disent usées par la quantité d’information (contre 37 % en 2019).
Cela se traduit par un phénomène d’« exode informationnel » : environ 30 % des Français se détournent totalement des sujets politico-médiatiques, ou se réfugient dans des espaces parallèles — parfois conspirationnistes.
Un chiffre résume la situation : 83 % des Français estiment que suivre l’actualité « déprime sur l’état de l’humanité ». Trop de conflits, trop de flux, trop d’impuissance. L’information, censée éclairer, finit par décourager.
Les médias face à leur miroir
La responsabilité des journalistes est directement posée. Pour Nina Fasciaux (Solutions Journalism Network), l’écoute est l’angle mort du métier. Dans son livre « Mal entendus« , elle dénonce des interviews souvent « transactionnelles », qui donnent aux sources l’impression d’être utilisées comme de simples ressources. Ce déficit d’écoute nourrit frustration et polarisation.
Charlotte Vautier, journaliste indépendante et créatrice de la chaîne OK Charlotte, a fait le même constat : une déconnexion croissante des médias traditionnels, où « les journalistes se parlent entre eux ». Elle cite la présidentielle de 2022 comme exemple : l’omniprésence d’un candidat (Zemmour) dans les médias contrastait fortement avec les préoccupations réelles du public … et son résultat effectif.
Pour elle, la transparence est une clé. Son propre modèle — basé sur YouTube et Patreon — associe ses abonnés dès l’amont de la production : elle les questionne sur ce qu’ils veulent savoir et comprendre avant de tourner. Et entretient la conversation ensuite.
Samuel Petit (Le Télégramme) a, lui, choisi la métaphore culinaire : l’info rapide et industrielle ressemble à de la malbouffe. Pour contrer cette « boulimie informationnelle », il plaide pour redonner de l’air et ralentir le rythme. Sa conviction : l’information doit concerner directement les gens. Preuve à l’appui, 85 % de l’audience quotidienne du Télégramme porte sur des sujets locaux ou bretons.
Sortir du piège de l’audience
Au-delà du constat, plusieurs pistes sont envisagées. D’abord, repenser la logique d’audience. David Medioni insiste : il faut passer d’une masse indistincte de lecteurs à un véritable « public » avec qui entretenir une relation.
Samuel Petit rappelle aussi la nécessité d’occuper les trois temps de l’information, notamment le « temps 3 » : celui de la valeur ajoutée, des enquêtes longues, des sujets qui impliquent directement les citoyens.
Nina Fasciaux défend le journalisme de solutions, qui montre non seulement les problèmes mais aussi les réponses possibles. Une manière de contrer le sentiment d’impuissance en mettant en lumière la capacité des humains à s’organiser et à agir.
Éducation, régulation, financement : un chantier global
L’éducation aux médias apparait comme une urgence. David Medioni propose d’en faire une matière obligatoire du CE2 à la Terminale, avec épreuve au bac à la clé. Objectif : apprendre non seulement à vérifier les faits, mais aussi à comprendre la logique algorithmique, la bataille de l’attention et le fonctionnement des plateformes.
Côté régulation, il plaide pour que les grandes plateformes — réseaux sociaux ou chatbots d’IA — soient enfin considérées comme des médias, avec les mêmes responsabilités que les acteurs traditionnels. D’ailleurs, Charlotte Vautier relève le fait que tous les grands médias sont aussi sur les réseaux sociaux et qu’il ne faut pas opposer les modes d’information. Il y a aussi de l’information de qualité, dans des formats parfois plus adaptés, sur les réseaux.
Reste la question du financement. Pour produire une information de qualité, encore faut-il qu’elle soit financée. Cela suppose que les citoyens comprennent l’économie des médias (privés, publics, financés par la pub ou le contribuable) et acceptent d’y contribuer.
Recréer de la confiance et de la fierté
Dernier chantier : restaurer la confiance et la fierté professionnelle. Cela commence par des gestes simples, comme répondre aux commentaires ou modérer les espaces de discussion. Mais aussi par une attention au langage : Nina Fasciaux invite les journalistes à s’inspirer des neurosciences pour mesurer l’effet de leurs mots, parfois exclusifs ou stigmatisants.
Enfin, il y a une dimension intime : les journalistes eux-mêmes doivent retrouver la fierté de leur travail, au lieu de projeter sur le public leur propre doute ou leur autocritique permanente.
« Le journalisme, c’est aller chercher l’information qu’on nous cache », a rappelé Samuel Petit en conclusion. Une formule qui sonne comme un retour à l’essence du métier : produire de la valeur, nourrir la curiosité, et surtout recréer du lien.
Alors, comment retisser une relation de confiance, ancrée dans les réalités locales, ouverte aux solutions, et capable de redonner envie de s’impliquer ?
Il faut sans doute ralentir, écouter, reconnecter. Et c’est un véritable fil rouge entendu dans nombre de témoignages au grès des différents ateliers et conférences du FIL : nombreux sont les journalistes ou les médias indépendants qui ont quittés des rédactions plus solides et plus confortables, pour pouvoir retrouver le temps de faire leur travail tel qu’il le conçoivent, tel qu’ils y trouvent du sens et de l’éthique.
L’information, quand elle est bien faite, n’épuise pas. Elle donne des clés pour comprendre et pour agir. Et c’est peut-être là, finalement, le vrai antidote à la fatigue informationnelle.