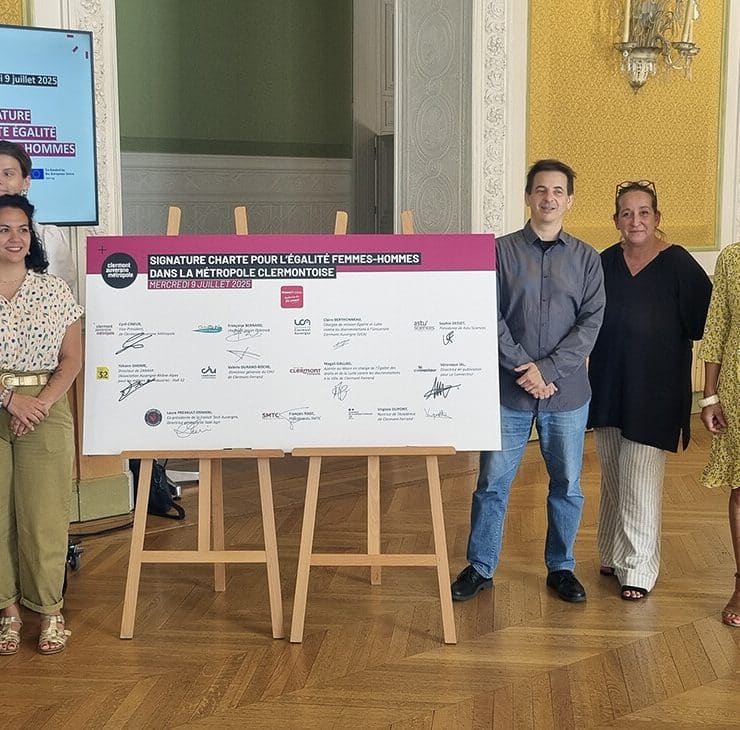Faire campagne
Parler du déclin du commerce de centre-ville en incriminant les seuls travaux, sans jamais contextualiser une tendance nationale (voire mondiale) liée à l’explosion du commerce en ligne.
Parler de criminalité et de trafic de drogue sans évoquer une économie illégale mondialisée, qui ronge jusqu’aux plus petits villages.
Ça, ça m’agace.
Je ne dis pas qu’il n’y a pas de leviers locaux et rien à faire d’autre que regarder passivement. Du tout. Mais je n’aime pas qu’on me fasse croire que c’est simple. Parce que ça ne l’est pas.
Et je me demande toujours comment se construit un discours politique, dans la tête d’un candidat. Est-ce qu’il part de ce qu’il pense vraiment ? Ou de ce qu’on lui dit que les “électeurs veulent entendre” ? Je l’imagine challengé par ses équipes, entre stratèges et communicants, obligé de simplifier, d’affirmer, de cliver.
Et au final, on aboutit à des programmes où les enjeux de fond sont traités comme des problèmes de surface. On gère les symptômes, pas les causes. On propose du visible, du quantifiable, du “concret” — comme si le reste ne comptait pas.
Ça m’a rappelé cette image empruntée à l’économiste Keynes : dans un concours de beauté, on ne vote pas pour celle qu’on trouve belle, mais pour celle que l’on pense que les autres vont choisir.
En politique, c’est pareil. On ne dit pas ce qu’on pense, mais ce qu’on croit que les autres attendent.
Et ce jeu pousse tout le monde à surjouer. À parler fort. À trancher. À proposer des réponses simples à des problèmes complexes.
Humilité
Le biais de surconfiance — connu sous le nom d’effet Dunning-Kruger — en est un bon symptôme : ce sont souvent ceux qui en savent le moins qui parlent avec le plus d’assurance. Et inversement, plus on creuse un sujet, plus on doute, plus on mesure sa complexité. (Lire notre article « Dunning Kruger, faut-il apprendre à la fermer ?« , il est ancien mais n’a pas pris une ride)
Mais dans une campagne, ce doute-là est vu comme un défaut.
On pourrait en rire si ce n’était pas aussi grave. Parce qu’à force, les débats publics s’appauvrissent. On caricature les positions, on désigne des responsables immédiats, on évite les interdépendances, les causes profondes, les temporalités longues.
Je ne pense pas que ce soit uniquement de la mauvaise foi. Je crois que c’est aussi le résultat d’un écosystème électoral biaisé. Où la sincérité n’est pas toujours “payante”. Où le format favorise la forme plus que le fond. C’est notre paradoxe d’électeur : un candidat qui dirait des choses intéressantes en bredouillant n’inspire ni confiance ni respect, un autre qui prendrait du temps pour expliquer et poser un cadre serait sans doute perçu comme ennuyeux, etc…
Alors oui, je reste perplexe. On dit vouloir des débats utiles. Mais on alimente sans cesse un jeu de postures. On réclame des élus courageux. Mais on récompense les certitudes simplistes.
On voudrait du changement. Mais pas de remise en question.
Et si on acceptait, collectivement, que les enjeux qui nous attendent ne tiennent pas dans un tract recto-verso ? Et qu’il y a un effort individuel et collectif à produire pour les appréhender
Bonne lecture, et bon week-end.
A écouter

Sur les marchés boursiers, ce qui compte n’est pas de déterminer la valeur fondamentale des titres, mais d’anticiper correctement les anticipations des autres investisseurs. Comme dans un concours de beauté en somme ?
Un podcast France Culture – Le pourquoi du comment