Pesticides, antibiotiques, modèle agricole à bout de souffle… Et si la solution n’était ni dans l’interdiction brute, ni dans le statu quo ? Yvon Darignac, entrepreneur engagé dans la transition agricole, défend une approche « raisonnée et raisonnable ». Son credo : proposer des alternatives viables : réduction des antibiotiques en élevage, biocontrôle, alimentation végétale, protection des abeilles…Rencontre avec un optimiste pragmatique, qui croit encore à la force du changement pour une agriculture durable en Auvergne.
Votre parcours professionnel est marqué par une diversité d’expériences, allant de l’agriculture aux énergies alternatives. Comment en êtes-vous arrivé là ?
Je suis originaire du Périgord et, depuis tout petit, j’ai toujours été attiré par la nature. À l’époque, je me voyais bien devenir vétérinaire, mais mon parcours a finalement pris une autre direction, avec des expériences variées, entre entrepreneuriat et projets innovants dans l’agriculture et l’environnement.
Par exemple, j’ai travaillé pendant un an sur un projet d’agrocarburants avec la Fédération nationale des planteurs de topinambours. L’idée était assez originale : on distillait des topinambours pour en extraire de l’alcool, qui servait ensuite à faire rouler des voitures.
Par la suite, j’ai intégré une entreprise où je me suis intéressé aux solutions naturelles pour fertiliser les sols et la protection végétale avec des méthodes alternatives . Mais comme ce n’était pas une priorité stratégique pour le groupe, j’ai choisi de reprendre cette activité en solo et de créer Solu Nature. Aujourd’hui, je développe des alternatives aux produits phytosanitaires, aussi bien pour la santé animale que végétale, toujours avec cette volonté de proposer des solutions plus respectueuses de l’environnement.
Aujourd’hui, l’agriculture fait face à de nombreux défis. Comment percevez-vous l’évolution du secteur et quelles sont, selon vous, les transformations à venir ?
En fait, l’agriculture est en train de se scinder en deux grands modèles. D’un côté, on va avoir une production régionale, identifiée, labellisée, avec une vraie dimension éthique. De l’autre, une agriculture plus mondialisée, axée sur les volumes.
Dans nos régions, il faut miser sur le premier modèle. L’agriculture intensive ne tiendra pas sur le long terme. Essayer de s’aligner sur les cours mondiaux, ce n’est tout simplement pas viable pour notre agriculture locale.
Ce qui lui permettra de survivre, c’est justement ce modèle basé sur la qualité et le respect de l’environnement et des consommateurs. Alors, on pourrait se dire : « Oui, mais tout le monde n’est pas prêt à payer pour ça. ». En réalité, il n’est pas nécessaire que toute la population adopte ce modèle. Si 30 % des consommateurs s’orientent vers ces produits, ce serait suffisant pour assurer la pérennité de cette agriculture durable.
Au-delà de cette mutation du secteur agricole, quelles autres évolutions vous semblent essentielles pour une agriculture durable en Auvergne ?
Et au-delà de cette évolution, je pense que l’on va aussi assister à une transformation de nos habitudes alimentaires, avec une consommation de produits carnés de qualité et une consommation végétale qui va prendre de plus en plus de place. Il y a aussi un vrai enjeu autour de l’innovation sur les produits végétaux.
Il faut progresser sur le plan nutritionnel, sur la production, et c’est ce que l’on fait aujourd’hui. On a investi dans un consortium pour créer Cocon, une entreprise qui développe des recettes à base végétale destinées à l’alimentation humaine. Notre première étape, c’est de proposer des bases végétales simples, avec l’ambition d’aller toujours plus loin dans cette transition alimentaire.
Finalement, ce qui va vraiment faire bouger les lignes, ce ne sont pas uniquement les agriculteurs, ce sont les consommateurs. C’est eux qui, par leurs choix, vont influencer la direction que prendra l’agriculture. On l’a bien vu avec des initiatives comme la marque « C’est qui le patron ? » qui est un franc succès. C’est bien la preuve que lorsque la demande évolue, l’offre s’adapte.
Vous dites que vous proposez des alternatives aux antibiotiques. Qu’est-ce que cela signifie concrètement ?
Prenons un exemple concret : les veaux à la naissance. Souvent, ils sont fragiles, ils tombent malades, et la solution classique, c’est de leur administrer des antibiotiques pour éviter qu’ils ne meurent.
Nous, ce que l’on propose, c’est d’anticiper le problème autrement. Plutôt que d’attendre que l’animal tombe malade pour le soigner, on travaille sur la prévention en renforçant son immunité dès le départ. À la naissance, on leur donne un cocktail de levures et de bactéries, sous forme de petites ampoules contenant 25 milliards de germes. L’idée, c’est d’installer directement une flore de barrière dans leur intestin, pour développer un microbiote protecteur.
Et le résultat est là : les veaux ne tombent plus malades, donc on n’a plus besoin de les traiter aux antibiotiques. C’est gagnant à tous les niveaux : d’abord, on réduit la mortalité, ensuite, on obtient des animaux en meilleure santé et des produits plus sains. Enfin, c’est économiquement plus intéressant pour l’éleveur, qui réduit ses coûts de traitement. En somme, on ne cherche pas simplement à supprimer un produit, mais à repenser les pratiques pour qu’elles soient à la fois efficaces et durables.
Vous échangez avec des agriculteurs et des éleveurs aux profils variés. D’ailleurs, vous insistez sur l’importance d’une agriculture raisonnée et raisonnable. Que mettez-vous derrière ces termes ?
Globalement, oui, j’ai plutôt un bon écho. Parce que je ne suis pas dans une posture radicale, je ne leur dis pas « Vous faites mal les choses. » Ce que je leur dis, c’est plutôt : « Essayons de faire autrement. »
Bien sûr, tout ne peut pas s’appliquer partout de la même manière. Dans certaines régions où l’agriculture est très industrialisée, la transition est plus complexe. Mais ce n’est pas une question de renoncer à un modèle, c’est une question d’évolution.
Aujourd’hui, le problème, c’est que l’on a surtout imposé des interdictions sans toujours proposer d’alternatives viables pour préserver les niveaux de production. Or, l’enjeu, ce n’est pas juste d’interdire, c’est d’accompagner la transition. Comment remplacer un produit phytosanitaire ? Comment se passer d’un antibiotique tout en garantissant des produits sains, un impact positif sur la biodiversité et un modèle économique qui fonctionne pour les agriculteurs ? Tout ça doit s’inscrire dans une vision globale, cohérente et pragmatique.
Cette approche demande du temps, parce qu’il faut lever des freins techniques et réglementaires. Mais contrairement à ce que l’on pense, des alternatives existent déjà. Il y a énormément de solutions de biocontrôle et d’autres approches innovantes qui montent en puissance, même si on en parle encore trop peu. On reste souvent bloqués sur les problèmes, alors qu’il y a déjà des réponses qui émergent.
C’est ça, une agriculture raisonnée et raisonnable : une agriculture qui évolue sans être brutale, qui prend en compte à la fois les réalités du terrain et les attentes sociétales, et qui construit progressivement un modèle plus durable.
L’impact des pesticides sur les abeilles est une question largement débattue. Qu’est-ce qui vous a poussé à vous pencher sur ce sujet et quelles découvertes avez-vous faites ?
Au départ, on nous a sollicités pour réfléchir à des alternatives aux pesticides, notamment face à la forte mortalité des abeilles. En creusant le sujet, nous nous sommes rendus compte que si les pesticides sont évidemment nocifs, ils n’expliquent pas tout. En fait, 80 % des cas de mortalité restent mal expliqués voire inexpliqués.
Alors, nous avons regardé ça de plus près et découvert que les abeilles sont aussi gravement affectées par des parasites et des virus. Aujourd’hui, il en existe près de 60 virus différents à travers le monde. Ces virus affaiblissent les abeilles au point qu’après avoir butiné, elles n’ont plus l’énergie de revenir à la ruche.
En travaillant sur ces causes moins connues, nous avons réussi à réduire drastiquement la mortalité sur nos ruches pilotes : nous sommes passés sous la barre des 5 %, alors qu’en moyenne en France, la mortalité tourne plutôt autour de 30 à 50 %. C’est une avancée majeure qui montre qu’en élargissant notre regard au-delà des causes évidentes, on peut trouver des solutions efficaces pour protéger les abeilles.
D’ailleurs, nous venons d’être labellisés France 2030 pour ce projet Bee-Full, cela signifie que l’on va pouvoir réinvestir 500 000 € dans cette innovation.
Face aux nombreux défis environnementaux et économiques, comment vous positionnez-vous ? Êtes-vous un optimiste convaincu, un réaliste pragmatique ou un peu des deux ?
Je dirais que je suis un optimiste, mais pas un naïf. Pour moi, il faut cultiver le positif et la bonne humeur, parce que c’est ce qui permet à l’intelligence de prendre le dessus sur les émotions. Et surtout, il ne faut pas tomber dans l’opposition systématique, dans le camp contre camp. À mon avis, on a déjà perdu trop de temps à faire ça.
La solution, pour moi, passe par l’innovation. L’innovation, c’est l’histoire de l’humanité. On ne pourra pas, avec notre modèle de société actuel, tout régler uniquement par des interdictions ou par des réglementations. Ça ne marchera pas. Ce qu’il faut, c’est trouver d’autres solutions, explorer de nouvelles voies pour une agriculture durable en Auvergne.
Et je peux vous dire qu’il y a des projets incroyables qui émergent et des entreprises vraiment engagées au niveau local. Il faut informer, il faut expliquer. C’est sûrement de cela dont on a le plus besoin aujourd’hui. C’est aussi pour ça que j’apprécie des médias comme Le Connecteur : vous mettez en avant des initiatives concrètes, des choses qui existent vraiment, et ça, c’est essentiel.
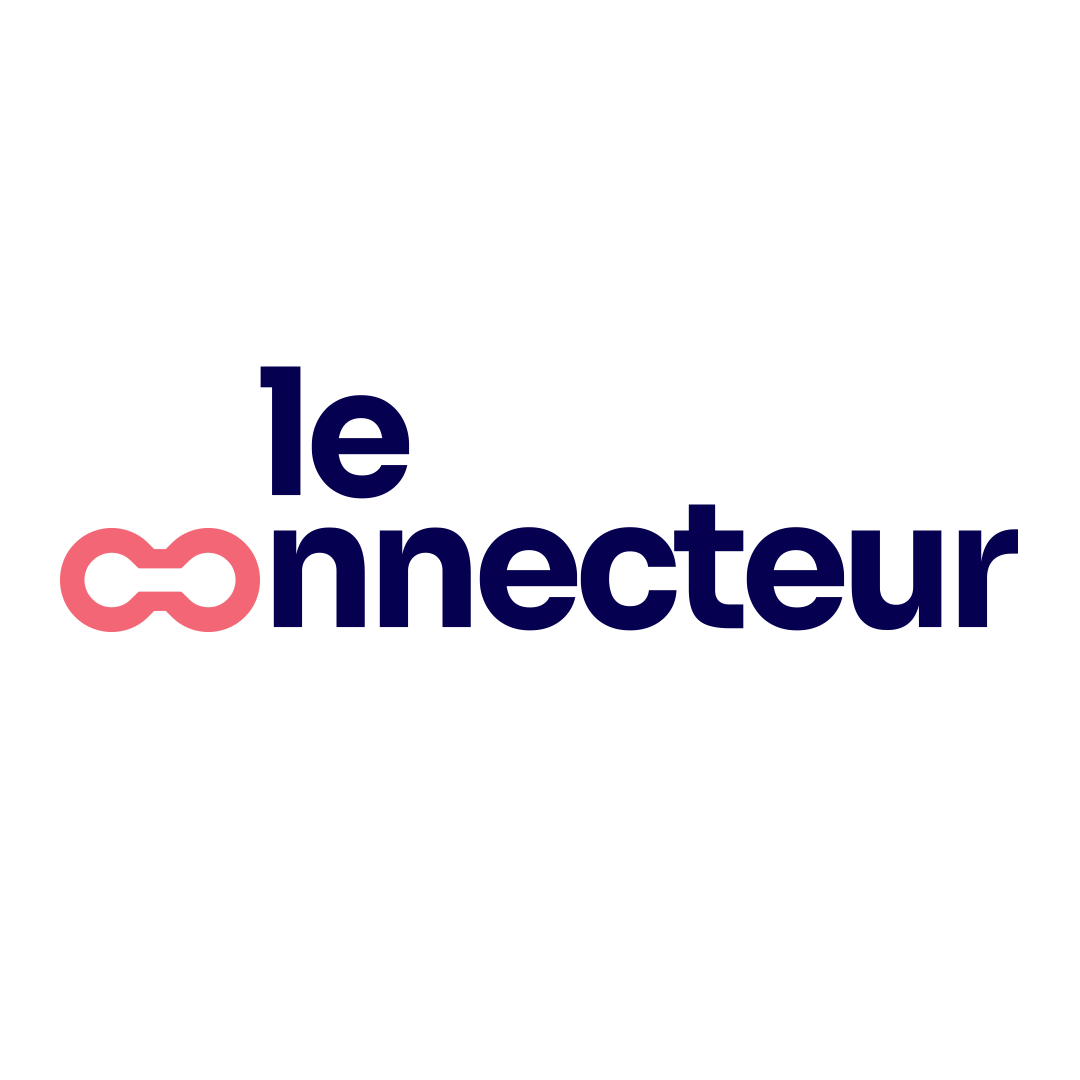


![[Podcast] Picture & GreenCouture, partenaires pour redonner vie](https://leconnecteur.org/wp-content/uploads/cache/images/ecosystemes-16-9/ecosystemes-16-9-2244122618.jpg)

![[Éclairage] Comment le vivant pourrait inspirer les organisations](https://leconnecteur.org/wp-content/uploads/cache/images/Template-visuels-Site-4-2/Template-visuels-Site-4-2-2732685301.png)
