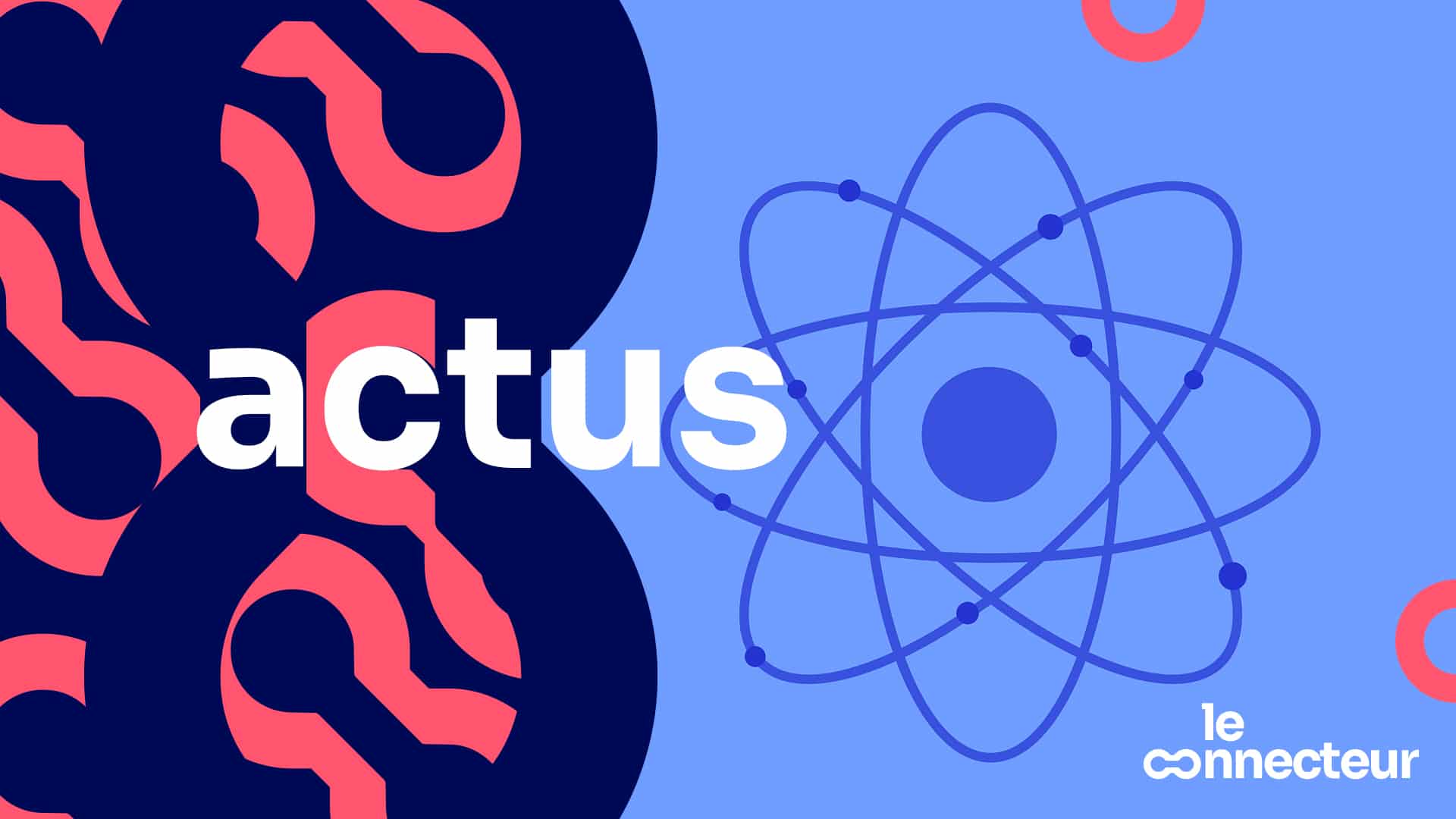Depuis deux siècles, la science a profondément transformé nos sociétés. Santé, technologie, transports : chaque jour, nous bénéficions des avancées de la recherche. Héritage des lumières, la science fait partie intégrante de la gouvernance du pays. Pourtant, même ce socle est aujourd’hui fragilisé. Une partie croissante de la population remet en cause l’autorité scientifique, soupçonne ses acteurs de partialité, voire doute de leur honnêteté. Cette crise de confiance ne sort pas de nulle part : elle s’inscrit à l’intersection de plusieurs dynamiques. Depuis l’avènement de Trump pour un deuxième mandat en janvier 2025, la vérité ne semble plus être importante, laissée au second plan pour répondre à un agenda politique. Enjeu financier, confusion politique, dérives éthiques, plusieurs facteurs, souvent imbriqués, viennent éroder la crédibilité de la science. C’est exactement le sujet de la conférence « sciences et public : crise de confiance ? » animée par Bernadette Bensaude-Vincent, historienne des sciences françaises et philosophe à la Sorbonne, le 9 avril 2025 à la maison du peuple de Clermont-Ferrand.
Article de Tristan Fraysse
L’enjeu financier : la dépendance des chercheurs fragilise l’image de la science
L’indépendance financière des chercheurs est un pilier de la crédibilité scientifique. Or, dans un contexte de ressources limitées, cette autonomie est mise à mal.
En France, la majorité du financement de la recherche reste publique. Environ 2,2 % du PIB y est consacré, mais cette enveloppe est loin de couvrir tous les besoins. Pour poursuivre leurs travaux, les chercheurs doivent souvent entrer en compétition pour obtenir des subventions. Ainsi, seulement 4 à 5% viennent de financements privés.
Ce contexte de rareté pousse certains à devenir de véritables « entrepreneurs scientifiques », il ne suffit plus de produire du savoir, il faut aussi vendre son projet, démontrer son utilité économique ou sociétale immédiate. Ceci peut, hélas, amener à délaisser une partie de la recherche pour une autre plus rentable.
Pour l’historienne, un autre facteur renforce cette défiance, la montée en puissance des brevets depuis les années 1980. Utilisés en masse, des pans entiers de la recherche pourtant d’intérêt général sont ainsi sous-étudiés. En verrouillant l’accès à certains résultats scientifiques pour des raisons commerciales, la logique des brevets va à l’encontre de l’idéal d’universalité de la science.
Dès lors, en France, 57% sont convaincus que les scientifiques ne sont pas indépendants (IFOP 2020). Ce manque de liberté financière amène forcément une défiance où le mythe du désintérêt scientifique est brisé. Outre l’aspect financier, une autre cause, et pas des moindres, explique cette crise. Le manque de différenciation entre scientifiques et politiques.
La science et la politique qui s’entremêlent.
Pendant la pandémie, les conseils scientifiques se sont multipliés pour guider les décisions publiques. Mais leur parole a été perçue par une partie de la population comme politique plutôt que scientifique.
À force d’injonctions contradictoires, de revirements stratégiques et d’interférences entre experts et gouvernants, une partie du public a perdu confiance.
De nombreuses théories du complot et de fakes news ont pullulé sur les réseaux sociaux. On retrouvait ainsi, par exemple, des théories sur le fait que les vaccins ARN modifient notre ADN ou alors, contiennent des puces 5G. Dans une autre mesure, un sondage IFOP de 2020 met en évidence que certains citoyens (17%) considèrent le gouvernement responsable de cette pandémie. Pour eux, le Covid-19 aurait été créé intentionnellement.
La science semble donc être de plus en plus liée à la politique, ce qui peut expliquer cette dégradation de la confiance. En effet, si on revient sur les chiffres, seuls 26% des Français ont confiance dans la politique (sondage CEVIPOF 2025).
Le cas américain
La conférencière nous parle du cas des États-Unis. Indispensable pour comprendre cette crise, elle évoque une nouvelle ère. Celle-ci semble avoir été franchi depuis l’arrivée de Trump à la tête du pays. L’ère de la post-vérité. En quoi cela consiste ? Vraisemblablement à la banalisation du mensonge. Les nombreux mensonges du 47ᵉ président des États-Unis, sont assumés sans détour devant les médias nationaux. Ils n’ont d’ailleurs pas entamé le soutien de son électorat, qui l’a reconduit pour un second mandat.
Donald Trump ne cible pas seulement la vérité scientifique, mais aussi la vérité journalistique. Parmi les exemples marquants, une coupe budgétaire de 2 milliards de dollars infligée à Harvard, accusée par lui de promouvoir le « wokisme » et l’antisémitisme, et une réduction de 4 milliards affectant la recherche médicale. Plus inquiétant encore, l’administration actuelle supprime des milliers de données gouvernementales portant sur la diversité et le genre. Pour de nombreux scientifiques, ces attaques mettent en péril l’indépendance de la science aux États-Unis. Comme semble le dire de nombreux scientifiques, la science est menacée aux États-Unis.
L’enjeu éthique : quand des intérêts privés pervertissent la science
Pour faire un tableau d’ensemble de cette tendance, il est également indispensable de parler des cas où la science faillit. L’industrie du tabac est l’illustration parfaite. En effet, de nombreux lobbyistes du tabac tentent de manipuler des études scientifiques pour relativiser la toxicité de la cigarette et ainsi limiter ou rendre controversé toutes les lois qui tenteraient de la limiter. On ne peut ici qu’évoquer le Council of Tobacco Research (CTR). Ce conseil créé en 1953 et financé par les cigarettiers avait pour mission d’orienter la recherche scientifique en faveur de l’industrie du tabac. On retrouve encore aujourd’hui cette stratégie.
On peut par exemple parler de la World Vaper’s Alliance. Celle-ci a lancé en 2021 une tournée en bus pour encourager les gens en Europe à vapoter en prônant la toxicité moindre à contrario du tabac. Financé par la British American Tobacco, celle-ci permet de faire du marketing sur ses propres produits tout en dénonçant les lois qui tentent de limiter son utilisation. Ce manque d’éthique de la part de certains scientifiques qui sont attirés par l’argent peut avoir des conséquences sur la confiance que la population porte à ce domaine. Néanmoins, tout n’est pas perdu.
Une image de la science qui reste positive.
Aujourd’hui encore, du moins en France et plus généralement dans l’Union européenne, la confiance en la science est toujours majoritairement là. Il suffit de voir les chiffres. Selon un sondage de l’IFOP réalisé en coopération avec Polytechnique, 92% des Français ont une bonne image de la science. Une dernière enquête de l’UE confirme cette tendance.
Avec un eurobaromètre, celui-ci montre que 83% des citoyens de l’UE soutiennent que l’influence de la science et de la technologie est favorable. La défiance ne semble donc pas venir de la matière en elle-même mais de tout ce qui l’entoure.
Même aux États-Unis, où le pays est en pleine ère de post-vérité, on a une majorité d’Américains qui ont confiance en la science (73%). Cette défiance semble dès lors être une issue d’une minorité politique et civile. Qu’ils vivent dans une forme de déni (biais cognitif, biais de confirmation) ou qu’ils choisissent délibérément de mentir pour défendre leurs intérêts. Dans tous les cas, le constat reste le même, face aux attaques et aux tentatives d’épuration que subissent aujourd’hui les scientifiques aux États-Unis, il est plus que jamais essentiel de protéger la science, socle commun de nos sociétés modernes.