Salomé Pinton est animatrice Technique du Syndicat des viticulteurs de l’AOC Côtes d’Auvergne et de l’IGP Puy-de-Dôme. Elle nous parle de l’évolution de ce vignoble depuis les années 50 et les ambitions que portent les professionnels pour les années futures. Sommes-nous au début d’une nouvelle histoire ?
Votre parcours semble intimement lié au monde agricole. Pouvez-vous nous en dire plus ?
Durant mon enfance, passée auprès de mes grands-parents éleveurs de vaches en Creuse, j’ai cultivé un attachement profond pour l’agriculture. Mon parcours académique a débuté par un bac S, suivi d’une licence en biologie et d’un master en école d’ingénieurs à Vetagro Sup, à Lempdes. La découverte du monde viticole, grâce à un proche de la famille œnologue, a orienté ma spécialisation vers ce domaine à Bordeaux. En 2021, mon stage de fin d’études à la Fédération Viticole du Puy-de-Dôme a débouché sur une embauche en tant que technicienne pour les AOC Côtes d’Auvergne.
En tant que technicienne en viticulture, quelles sont vos principales missions ?
Mon rôle s’articule autour du conseil agronomique aux vignerons et viticulteurs, avec lesquels je suis en interaction constante. Face à leurs problèmes ou difficultés, je suis leur premier point de contact pour trouver des solutions. Je supervise également les nouvelles installations viticoles et je m’occupe du conservatoire des cépages anciens à Cournon d’Auvergne.
Face à quels défis le vignoble AOC Côtes d’Auvergne doit-il actuellement se mesurer ?
L’Esca est une maladie qui entraîne un dépérissement des souches, dû à un champignon basidiomycète (couramment appelés « champignons à chapeau ). Cela touche l’ensemble du vignoble français, alors nous faisons de la recherche pour mieux lutter contre.
L’autre sujet de préoccupation est le dérèglement climatique. La chaleur, le gel et/ou la grêle peuvent avoir des conséquences graves sur les vendanges.
Par exemple, lorsqu’il y a un épisode de grêle comme ça a pu être le cas en 2021, le vigneron perd une partie plus ou moins importante de la récolte. Après de forts dégâts, les ceps ont tellement souffert, qu’il faut souvent les laisser une année sans production pour se remettre. Ce sont donc deux récoltes qui sont impactées et des conséquences économiques qui durent dans le temps pour les viticulteurs.
Parlez-nous un peu du vignoble d’Auvergne…
Après la Seconde Guerre mondiale, le vignoble s’étirait sur 1000 hectares. Il a été en déclin jusque dans les années 2000, avant qu’une nouvelle impulsion ne soit donnée. Depuis, on replante environ dix hectares de vigne chaque année.
Aujourd’hui, il fait 80 kilomètres de long du Nord au Sud et 20 kilomètres d’Est en Ouest. Nous avons 120 vignerons et viticulteurs répartis sur 350 hectares de vignes plantées. Ce sont plutôt de petites exploitations qui font 5-6 hectares en moyenne, même si nous avons quelques grands domaines. Aujourd’hui, le vignoble compte 35 caves indépendantes et 65 apporteurs à la cave coopérative. Du côté des apporteurs, nous avons une très grosse majorité de céréaliers qui ont choisi de se diversifier dans la vigne.
Le vin rouge représente plus de 60 % de la production, le vin blanc 15% et le vin rosé 25%. Actuellement, la demande est très forte en vin blanc, et la production à du mal à répondre.
Quels sont les obstacles pour devenir vigneron en Auvergne ?
L’accession au foncier est simplifiée pour ceux issus d’une famille de vignerons. Toutefois, la principale difficulté réside dans la rareté des terrains constructibles adaptés à la vinification. Les Plans Locaux d’Urbanisme intègrent certes les terres agricoles, mais trouver un terrain pour bâtir un chai peut s’avérer complexe.
L’investissement initial nécessaire à l’installation est également considérable, notamment pour l’achat du terrain et l’équipement du chai. Un hectare planté vaut environ 35 000 euros. Sur un hectare, on peut avoir au minimum 4 400 ceps en AOC. Enfin, si on souhaite avoir son chai, il faut ajouter plusieurs centaines de milliers d’euros de matériel et de construction.
Pourtant, il y a bien de nouvelles installations de vignerons en Auvergne ?
Oui, depuis mon arrivée, j’ai pu accompagner deux projets sur de petites surfaces. Un premier sur des parcelles existantes et un autre où le projet part de zéro. Les profils aussi sont très différents par rapport aux générations précédentes. Il y a quelques décennies, les vignerons étaient majoritairement autodidactes. Aujourd’hui, on retrouve des profils d’œnologues ou d’ingénieurs.
Ils ne sont pas forcément natifs de la région, mais ils ont choisi l’Auvergne pour son potentiel et aussi parce que le prix des terrains viticoles reste encore accessible comparé à d’autres régions de France.
Certaines personnes trouvent que les vins d’Auvergne sont chers par rapport aux autres vignobles. D’ailleurs, on évoque une augmentation de 18 % en valeur sur les dix dernières années. Comment expliquez-vous cela ?
Par l’offre et la demande. Aujourd’hui, nous avons une demande très forte et un vignoble qui est en développement. De plus, 40 % des ventes se font au caveau grâce aux clients fidèles et à l’œnotourisme. C’est ce qui limite le nombre de bouteilles disponibles à la vente en supermarché ou chez les cavistes locaux.
Autre précision. Les consommateurs de vins d’Auvergne sont plutôt de la jeune génération. En effet, chez les générations précédentes, nos vins souffrent encore d’une image négative. Pourtant, la qualité de nos vins s’est beaucoup améliorée depuis 20 ans !
Quelle est la place du bio sur le vignoble ?
Les parcelles bio représentent 16 % de la surface totale du vignoble. C’est vraiment beaucoup comparé à la moyenne nationale qui tourne autour de 6 %.
Même sans certification bio, de nombreux vignerons pratiquent une agriculture raisonnée, minimisant l’usage des intrants et privilégiant les interventions manuelles. Par rapport à d’autres vignobles, nous avons la chance d’avoir des parcelles très espacées ce qui limite le risque de propagation des maladies et donc la nécessité d’avoir recours à une quantité importante de produits phytosanitaires.
A quoi ressemblera le vignoble d’Auvergne dans 30 ans ?
Nous devons nous adapter au changement climatique. Il faudra nécessairement modifier le cahier des charges de l’AOC et l’IGP pour faire rentrer de nouvelles variétés plus résistantes à la sécheresse. En effet, pour l’AOC Côtes d’Auvergne, nous n’avons pas le droit d’irriguer les vignes. Il ne faut pas oublier que la vigne est une plante qui nécessite très peu d’eau.
L’adaptation au changement climatique sera cruciale, nécessitant probablement la révision de notre cahier des charges pour inclure de nouvelles variétés résistantes à la sécheresse. En effet, pour l’AOC Côtes d’Auvergne, nous n’avons pas le droit d’irriguer les vignes.
Aujourd’hui seuls le Chardonnay en blanc, le Gamay et le Pinot noir en rouge sont autorisés dans le cahier des charges de l’AOC. Avec le conservatoire des anciens cépages de Cournon-d’Auvergne, nous menons des études sur plusieurs années pour identifier les variétés septentrionales les plus propices pour notre climat futur.
C’est l’instant carte blanche, quelque chose à ajouter ?
Nous menons aujourd’hui un travail très important de cartographie des différents terroirs de l’AOC Côtes d’ Auvergne et de l’IGP Puy-de-Dôme. C’est une approche scientifique pour mieux connaître les sous-sols, notamment pour les réserves utiles en eau, la typologie du sol etc. Ces données sont très importantes aujourd’hui pour les vignerons, et elles le seront encore plus dans les années à venir.
Cela permettra également de mieux orienter les nouveaux porteurs de projets viticoles et d’identifier les cépages les plus propices en fonction des résultats.
Ce type d’initiative se multiplie en France. Aujourd’hui, on peut découvrir la cartographie complète des terroirs viticoles du Val de Loire par exemple. C’est une mine d’information. Nous venons d’initier cette démarche dans le Puy-de-Dôme et elle nous mobilisera d’abord sur les 350 hectares de vignes plantées, puis dans un second temps, sur les autres terrains propices à la vigne.
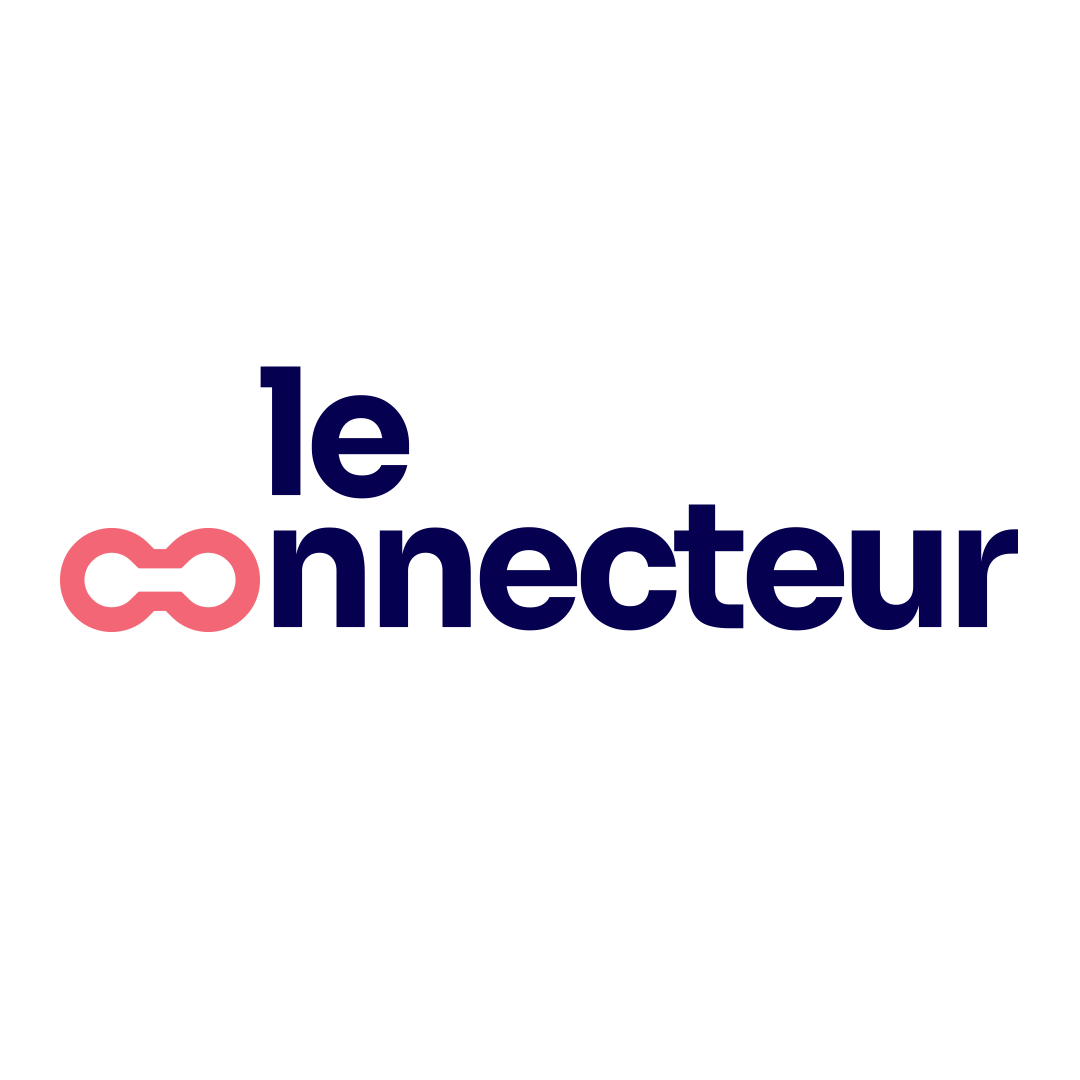

![[Podcast] Picture & GreenCouture, partenaires pour redonner vie](https://leconnecteur.org/wp-content/uploads/cache/images/ecosystemes-16-9/ecosystemes-16-9-2244122618.jpg)

![[Éclairage] Comment le vivant pourrait inspirer les organisations](https://leconnecteur.org/wp-content/uploads/cache/images/Template-visuels-Site-4-2/Template-visuels-Site-4-2-2732685301.png)
